Le quatrième album de Jacques Surette déçoit.
Le milieu des beaux-arts au Canada, surtout dans les communautés acadiennes et francophones, vit depuis longtemps un drôle de paradoxe.

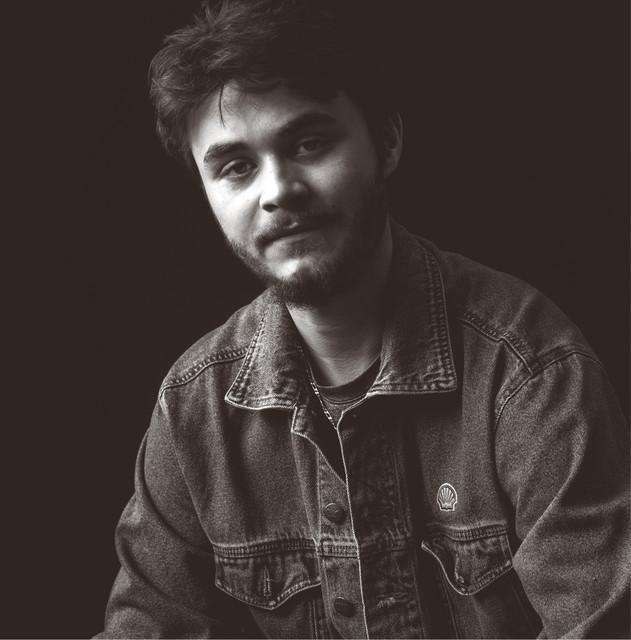
Culture null
Les gardiens de la médiocrité : comment les oligarques culturels exportent le beige pendant que le vrai talent est muselé
Le milieu des beaux-arts au Canada, surtout dans les communautés acadiennes et francophones, vit depuis longtemps un drôle de paradoxe. On se vante de célébrer la diversité et l’innovation, mais dans les faits, les gardiens du système continuent d’élever la médiocrité à coups de réseaux de favoritisme politique. Ce petit cercle fermé de l’industrie patrimoniale a créé un climat étouffant où les projets formatés et nostalgiques reçoivent les subventions, tandis que les voix artistiques vraiment fortes se font tasser. L’exemple de Jacques Surette et le silence entourant Cajun Dead et le Talkin’ Stick mettent en lumière ce problème avec une clarté dérangeante.

L’enfant chéri de Radarts : la nostalgie en série comme politique culturelle
Le quatrième album de Jacques Surette résume à lui seul tout ce qui ne va pas dans la musique francophone subventionnée au Canada. Appuyé par des organismes comme Radarts et soutenu par les liens incestueux entre fonctionnaires culturels et leurs artistes favorisés, Surette livre un album d’une banalité renversante. Des chansons sur « quatre vieux chapeaux » et sur le bonheur de « conduire sa petite auto noire » — ça passerait à peine à un concours de talents de centre communautaire. Pourtant, cette œuvre reçoit la promo de la Place des Arts d’Ottawa, du temps d’antenne à la radio, et même des éloges de la part de critiques, des institutions censées encourager l’excellence.
Le problème, c’est pas juste que l’œuvre manque d’originalité ou de profondeur — c’est que son succès est le résultat d’un choix conscient : les administrateurs préfèrent ce qui ne dérange pas, ce qui est « safe ». On finance le déjà-vu, on récompense ceux qui restent dans les limites acceptables de la nostalgie médiocre. C’est du matériel d’amateur vendu comme art professionnel, soutenu par un système qui valorise la loyauté politique plutôt que la prise de risque créative. Quand la subvention devient une récompense pour l’obéissance plutôt qu’un tremplin pour innover, tout le milieu finit par s’asphyxier.

Le génie fantôme : comment on efface Cajun Dead et le Talkin’ Stick
Pendant ce temps, les vrais innovateurs se font « ghoster ». Ignorés, non financés, écartés des réseaux de diffusion qui pourraient leur donner une vraie visibilité. Cajun Dead et le Talkin’ Stick incarnent exactement le genre d’art que nos institutions devraient défendre : des paroles fouillées, une musique audacieuse, un dialogue entre tradition et modernité. Leurs chansons rendent hommage à Édith Piaf tout en explorant des thèmes comme la gratitude à travers la métaphore des « deux branches » — un bel exemple d’art enraciné dans le présent tout en respectant le passé.
Lànge Piaf et la gang de les gamins de Paris
Chantant pour du change et du pour boire la nuit
Du change sur le bord de la rue
Il en a plus raique plus en a la vues en a la vues
Y'a pus parsonne qui chante avec l'âme comme elle faisait
Puis d'Édith pour pleurer la vraie misère humaine en effet
Les artistes du jour, y font juste du bruit pour vendre
Mais le coeur qui pleure pour le vrai du vrai, y'est pus là pour entendre
Du jours au lèndemoine, c`la qui sèn viens et c`la qui sèn vonne
D’icettes au jours et au lèn lèndemonne
Faites en créative faillite bien raid dans les beaux-arts
Fin du Saeculum, le braquage de l’Enfer
Cèst juste le coeur qui finirai a nous dire
Lànge Piaf et la gang de les gamins de Paris
Chantant pour du change et du pour boire la nuit
L'Ange Piaf et la gang de les gamins de Paris
Chantant pour du change et du pour boire la nuit
Du change sur le bord de la rue
Il en a plus raique plus en a la vues en a la vues
Ils disent qu'une chienne a toujours agare a ces choses
Dans un feedback loop de Vie en Rose
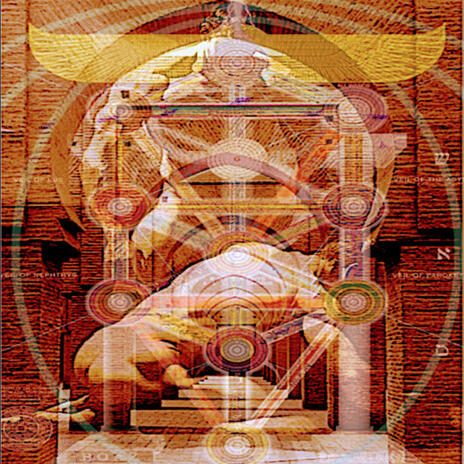
Mais surtout, Cajun Dead aborde de front des enjeux actuels avec un courage poétique. Leur travail sur les massacres de Gaza fait ce que le grand art politique a toujours fait : transformer l’horreur en beauté sans en diminuer le poids. C’est une forme de justice poétique mise en musique. C’est de l’art qui ose, qui ne se cache pas derrière des tounes de party de cuisine, qui demande quelque chose de plus à son public que juste une dose de nostalgie confortable.
Et c’est justement pour ça qu’ils restent en marge. Le système fermé, géré par des fonctionnaires politiquement branchés, ne peut pas tolérer un art qui dérange ou dépasse les cadres établis. L’innovation est perçue comme une menace. Les artistes qui refusent de se plier aux modèles poussiéreux approuvés par les comités sont exclus des subventions, des radios et des critiques. Le vrai talent se fait ghoster parce que le génie dérange ceux qui vivent de la médiocrité.

Coincés en 1975 : le modèle dépassé de la « gang de la baie »
La musique de la « gang de la baie » résume bien la dissonance temporelle au cœur du problème. Leur univers artistique reste figé dans les années 1970 : la « fierté » et les « partys de cuisine » — des thèmes qui pouvaient être vivants à l’époque, mais qui sonnent aujourd’hui comme des pièces de musée. C’est de la nostalgie sur de la nostalgie, une copie d’un souvenir déjà trafiqué. Continuer à produire ce genre de matériel en 2025, c’est comme faire semblant que les cinquante dernières années n’ont jamais existé.
Version Anglais a lire
Le monde a changé. Le numérique a transformé la musique, sa création, sa diffusion et son écoute. Les jeunes veulent de l’authenticité, de l’engagement et de l’innovation qui parlent de leur réalité — pas celle de leurs grands-parents. Mais l’esthétique de la « gang de la baie » reste figée dans le passé, complètement à côté de la track. En 2030, ce genre d’approche ne sera pas juste dépassé — elle sera incompréhensible. Un vestige d’une époque où les gardiens de la culture pouvaient encore isoler leurs favoris du vrai public.
La gang bureaucratique : racisme, favoritisme et exportation du beige
Ce qui rend la situation encore plus troublante, c’est le racisme structurel qui se cache souvent derrière ces réseaux de favoritisme. La « gang de fonctionnaires » qui contrôle les subventions et les canaux de diffusion suit souvent des critères non écrits qui favorisent certains milieux, certains visages, certaines esthétiques — et qui excluent le reste. Ce n’est pas seulement une question de goût : c’est un système de pouvoir qui s’auto-protège.
Résultat : les institutions culturelles canadiennes, censées refléter la diversité et encourager l’excellence, exportent plutôt de la médiocrité. On promeut des artistes comme Surette, qui n’apportent ni défi ni innovation ni regard sur le présent. On finance des projets qui auraient pu sortir en 1975. Et tout ça en se félicitant d’« appuyer la culture canadienne », comme si la culture était un artefact à préserver plutôt qu’un dialogue vivant.
Cette situation dépasse les cas individuels. C’est une trahison du rôle même de l’art : dire la vérité et chercher la beauté, et non flatter le pouvoir. Quand Cajun Dead parle de Gaza avec un courage poétique, tandis que Surette chante sa petite auto noire avec l’appui du gouvernement, on voit toute la faillite morale du système.
Conclusion
Le vieux réseau patrimonial canadien continue d’étouffer la vraie innovation artistique pendant qu’il célèbre la médiocrité confortable. Tant qu’on ne réformera pas les structures de financement, tant qu’on ne demandera pas de comptes aux bureaucrates culturels, et tant qu’on ne remplacera pas la gang des copains par des curateurs qui croient vraiment à l’excellence artistique, on va continuer à voir les vrais artistes passer dans le vide pendant que la nostalgie plate reçoit les applaudissements. Ce n’est pas une politique culturelle, c’est un suicide collectif en slow motion. Le tsunami s’en vient, et d’ici 2030, les institutions qui refusent de changer vont se faire balayer — avec leurs chouchous subventionnés — pendant que les artistes qu’elles ont ignorés bâtiront quelque chose de vrai sur les ruines.





